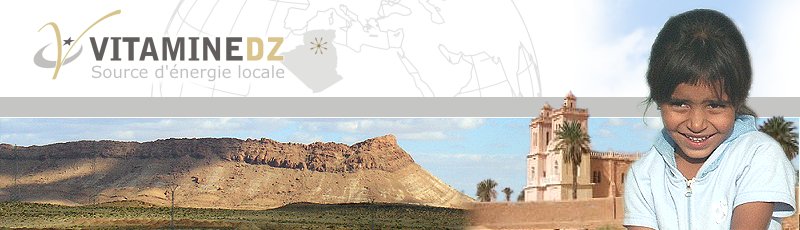
Taouila
On arrive aux différents qçour par des pistes en relativement bon état, ce qui est méritoire, car l'entretien est difficile. Jeeps et landrovers y roulent bien et font voir des paysages d'une étrange fraîcheur et d'une sauvage beauté. Pour arriver à Taouïala, capitale des Ouled Sidi-Hamza, l'on suit d'abord la longue et large vallée de Faïja, aux lignes douces, aux couleurs printanières (vert amande, rose pâle, mauve) assez inattendues dans un pays aussi rude. Puis l'on accède au belvédère et à la belle descente en lacets sur une plaine basse bornée à l'horizon sud par la chaîne du Kef el Melha, la Montagne de Sel, la frontière du vrai Sahara, d'où les barres de sel gemme sont apportées par chameau le dimanche au marché d'Aflou.
Deux émeraudes sombres sont enchâssées dans l'or pâle de la plaine : le grand qçar de Taouïala et le petit de Khadra, avec leurs quarante cinq hectares de jardins pleins de figuiers, poiriers, pêchers, abricotiers, grenadiers, cognassiers, pruniers et même pommiers. En avançant un peu on aperçoit, à droite, les Toumiates, les Jumelles, deux collines voisines d'un profil exactement semblable. En prenant, au pied de la falaise, un chemin à gauche, remontant l'oued, on trouve deux maqâms, petites constructions de pierres sèches formant courettes, l'une rectangulaire, l'autre carrée, à ciel ouvert, avec minuscules pignons d'angle. Elles sont dédiées, la première à Sidi-Cheikh, le fameux Saint d'El-Abiodh, ancêtre de la grande confrérie du Sud-Oranais, l'autre à Sidi-Aïssa Ben Mohamed qui a son tombeau monumental dans la localité du même nom, sur la route d'Aumale à Bou-Saâda.
Il y a là un exemple assez curieux, où l'on saisit sur le vif les rapports de l'hagiographie et de la sociologie. Les deux saints passent pour s'être rencontrés ici, avoir rivalisé de miracles et s'être mis d'accord pour fixer les limites territoriales de leur influence spirituelle et temporelle. Comme Sidi-Cheikh lui demandait son nom, Sidi Aïssa répondit : " Je suis Aïssa le Miracle. Et toi - Moi je suis le Miracle des Miracles. Montre-moi ce que tu saisfaire - Eh bien ! ferme les yeux ". Quand Sidi Cheikh les eut rouverts, il vit toutes sortes de fruits et des vignes chargées de raisins hors de saison. Mais quand Aïssa eut à son tour fermé et ouvert les yeux, il vit un nuage de sauterelles qui s'attaqua aux vignes et à ses propres vêtements. Convaincus mutuellement de leurs pouvoirs, ils crachèrent dans la rivière dont l'eau, de salée qu'elle éLait, devint douce. La frontière put donc être fixée sur l'oued Qçab. Et depuis ce temps, les gens de Taouïala envoient aux deux qoubbas le tribut religieux, en produits des jardins, fixé rigoureusement, en ce qui concerne Sidi-Cheikh, sur la jour-née d'eau d'irrigation de chacun. A Sidi-Aïssa, l'on donnait chaque année une jument harnachée ; aujourd'hui, Taouïala donne seulement la couverture ou djellâl. Près des deux maqâms, on célèbre au printemps un thaâm commun aux deux saints, après s'être cotisé pour acheter des moutons à immoler. C'est alors l'occasion de la corvée collective pour réparer la séguia qui amène aux jardins l'eau de l'oued prise un peu plus haut.
Le qçar a des fortifications assez importantes : des murs à créneaux en grès et argile, hauts de cinq à huit mètres, faisant une circonférence d'environ un kilomètre, avec quatre grandes tours d'angle et deux hautes portes. C'est à Touïala que l'agha Djelloul grand seigneur féodal assez terrible (fils de l'agha Yahya Nourreddine, Cheikh des Amour, dont il apporta la soumission à Lamoricière en 1843), s'était construit un " palais " qu'il n'eut guère le temps d'habiter et dont il ne reste que quelques pièces avec des arcs surbaissés et des piliers à chapiteaux. Les maisons du qçar sont en général soignées, construites par des maçons professionnels des environs, en pierres de grès et calcaires jurassiques, argile, plâtre et chaux. Les terrasses sont' supportées par des poutres de genèvrier soutenant des branchages de laurier, des tiges d'alfa mêlées d'argile. Un quart peut-être des maisons ont un étage avec fenêtres grillagées sur la rue. Les pièces donnent sur une cour intérieures et sont munies de cheminées édifiées en briques de terre séchée dans l'épaisseur des murs.
Les Taouïalis sont soigneux et propres. La plupart des ménages sont monogames. Les femmes ne sont ni cloîtrés ni voilées. Elles ont de beaux bijoux transmis soigneusement dans les familles ; des tatouages en arbres, en escaliers, en croix terminées par des E majuscules. Elles tissent des tapis et des burnous ; certaines font de la poterie. Aux quatre fêtes et aux ouâdhas, les hommes tirent au fusil, les femmes dansent et chantent. A la fête de Sidi Cheikh en avril, les deux fractions offrent chacune trois moutons, dont les morceauxsont répartis, avant d'être cuits entre toutes les familles.
Comme l'a remarqué M. Hellot, administrateur des Services Civils, qui a étudié à fond ce curieux qçar, vers 1949, et a rédigé à son sujet une monographie qui est un modèle du genre, c'est la vénération de Sidi Cheikh qui est comme le ciment moral d'une population d'origines très diverses : anciens habitants d'un vieux qçar, Karsifa, construit sur une des Toumiates, de Charef qçar plus récent sur un mamelon voisin, antérieur à l'établissement sur l'emplacement actuel rendu possible par l'adoucissement de l'eau (d'où l'ancien nom de Taïba) ; gens venus plus récemment de Chellala, Vialar, Sidi-Bouzid, de Laghaouat, du Gourara et même de Saint-Arnaud. L'ensemble de cette population est réparti en deux çofs Ouled Sassi (quartier est) et Ouled Turqui (quartier ouest), ayant chacun sa mosquée, son minaret, et sa rue. Entre les deux quartiers, se trouve la mai-son de Sidi Cheikh qui abrite un puits de trente-trois mètres creusé par le saint. L'eau guérit la fièvre et la toux. On ouvre rituellement ce puits entemps d'épidémie ou de sécheresse, et chaque an-née en été. On tue ,alors une chèvre que l'on cuit sur place et dont on partage les morceaux.
Le cimetière dominé par la coupole sur tambour mince (caractéristique de la région de Géryville d'où vint d'ailleurs le maçon qui la construisit) de Sidi Amar ben Barkat, ne manque pas d'allure. Ce saint passe pour être venu de Biskra au XVII"1e siècle et avoir d'abord enseigné à Tajrouna avec Sidi Mohammed Ben. Youssef. Un autre mausolée est celui de Sidi Mohammed Ben Athillah Ben et Kiwar, né à El Ghicha au XVII11e siècle, et qui passe pour avoir dompté un lion qui ravageait les alentours de Taouïala. Outre deux ou trois familles israélites, le qçar a deux familles de forgerons, anciens nomades naïlis, fixés ici et qui vivent à part. On connaît l'espèce de tabou qui existe en Afrique à l'égard des forgerons, caste bien tranchée, à la fois sacrée, redoutée et tenue à l'écart tout en étant appréciée pour' les services qu'elle rend ; tabou qui vient sans doute de la sorte d' " horreur sacrée " ressentie par les hommes préhistoriques au moment de la découverte et de l'utilisation des métaux.
Posté par : hbenghia
Ecrit par : Emile Dermenghem
Source : alger-roi.fr/Alger/documents_algeriens/monographies/pages/14_djebel_amour.htm