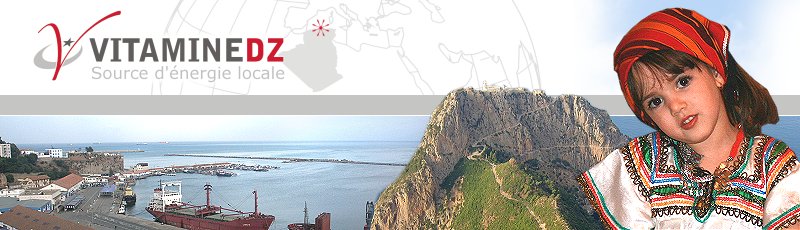
Histoire du village d'Ighram, Béjaia
A l'entrée d'IGHRAM, on trouve une grande porte où il y a un gardien, il l'ouvre le matin et la ferme le soir ou pendant les attaques.
L'année 1930 marque l'anniversaire du centenaire de la conquête française en Algérie. Des milliers de visiteurs viennent pour voir les réalisations des Français, sans toutefois se soucier combien de telles fêtes peuvent humilier le peuple musulman.
La période 1926-1930 est une période de prospérité, l'économie va bien et un climat de bien-être s'est installé. Pendant les fêtes du centenaire, des tracts, visiblement de nature communiste, sont distribués, dénonçant le colonialisme français. Plusieurs manifestations ont lieu, mais jusque là, tout se passe dans le calme. Déçus de ne pas se faire comprendre, les Musulmans protestent contre les injustices de " leurs frères ". Ces protestations gagnent de l'importance d'année en année, jusqu'en 1936, bien que les Algériens croient toujours à leur attachement à la France.
Après la visite du ministre de l'Intérieur, Régnier, en mars 1935, un décret est mis sur pied, limitant la liberté d'expression, ce qui incite le journal La Défense à écrire : " Le Musulman algérien de 1935 n'est encore que le vaincu de 1830. " Les étudiants musulmans prônent le nationalisme, insistant sur le fait que l'Islam est leur religion, l'Algérie leur patrie et l'arabe leur langue. On peut déjà sentir la progression du nationalisme. Certains craignent que les indigènes ne se révoltent pendant que Maurice Violette, ex-gouverneur général, propose un projet de loi permettant l'acquisition de la nationalité française à l'élite indigène; projet qui sera refusé par les politiciens.
Lors du discours de Constantine, le 12 décembre 1943, le gouvernement provisoire du général de Gaulle promet de sérieuses réformes, mais rien de cela ne peut stopper l'idéologie algérienne voulant la souveraineté du pays, étant depuis bien trop longtemps sous la tutelle de la France. Après les émeutes suivant les célébrations de la victoire en mai 1945, des centaines de colons européens sont tuées, ainsi que des milliers de musulmans, suite à la réplique de la France. La métropole, Paris, ordonne alors la dissolution de tous les partis nationalistes, puis proclame une amnistie en 1946.
L'Algérie est dépendante à la France, mais possède une Assemblée ayant autant de représentants français qu'algériens. En 1946, de nouveaux mouvements nationalistes se créent. Le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (M.T.L.D.) est prêt à aller jusqu'au bout pour avoir l'indépendance, quitte à se battre. Ce dernier parti crée le Comité révolutionnaire d'unité et d'action (C.R.U.A.) en 1954. Vers la fin de cette année, lors d'une réunion tenue secrète, les membres du C.R.U.A. viennent à accepter le déclenchement de l'insurrection de l'armée.
Le Front de libération nationale (FLN) est mis sur pied, à partir de divers mouvements nationalistes. Le 1er novembre 1954, la guerre de libération est déclenchée, les groupes armés du C.R.U.A. passent à l'action, la guérilla s'étend dans les villes ainsi que dans les campagnes et prennent d'assaut les réseaux de communication, les bâtiments publics, l'armée et les fonctionnaires algériens qui travaillent pour la France. Pierre Mendès France, à la tête du gouvernement français, et François Mitterrand, alors ministre de l'Intérieur, essaient en vain de garder un climat sain dans le maintien de l'ordre. Le FLN, nullement intéressé à faire la paix, force les Algériens à les rejoindre. Jacques Soustelle, gouverneur général depuis janvier 1955, est envoyé pour entreprendre des négociations avec les nationalistes. Le 20 août 1955, des rebelles, dans le Constantinois, massacrent 123 colons : hommes, femmes et enfants. Les Français répondent en tuant près de 12 000 Algériens dans la même région. Les réformateurs et Jacques Soustelle, abandonnent les démarches de négociations, l'état d'urgence est déclaré. Vers la fin de 1955, des renforts de l'armée française arrivent, on dénombre alors 400 000 hommes. On peut désormais sentir le climat de guerre. Dès le mois de septembre 1956, le FLN augmente son "quota" de guérilla dans les villes, surtout dans la ville d'Alger. Des attentats à la bombe ont lieu dans des cafés et des endroits publics. Le général Massu se voit attribuer les pouvoirs de la police d'Alger. C'est ainsi que commence la "Bataille d'Alger".
La bataille d'Alger est un sombre épisode de la guerre d'Algérie: des Algériens sont torturés par des militaires français, certains meurent au cours des interrogatoires qui n'en finissent plus. Les Français semblent se venger de ce que les Algériens leur ont fait subir. Dans un témoignage télédiffusé en 1984, Yacef Saadi, chef militaire du FLN, explique comment il a organisé ses hommes pour aller placer des bombes dans des cafés fréquentés par des jeunes Européens. Des poseurs de bombes français sont mêmes guillotinés. Le 26 janvier, des bombes explosent dans 3 cafés: l'Otomatic, la Cafétéria, le Coq Hardi; bilan: 5 morts et 34 blessés graves. Au cours du printemps 1957, les attentats se perpétuent. Le 9 juin, au Casino de la Corniche, le gardien dépose une bombe sous le podium de l'orchestre. Quelques minutes plus tard, 11 personnes meurent et 35 autres sont blessées. La plus grande partie des terroristes est éliminée ou neutralisée. Les dirigeants du FLN lancent une grève générale vers la fin du mois de janvier 1957, avant que l'ONU ne se mêle de la guerre. Deux jours plus tard, la grève est stoppée par les paras. Le 25 février, Larbi Ben M'Hidi, le chef du FLN, est capturé. Selon la version officielle, on l'aurait retrouvé pendu dans sa cellule le 4 mars.
On dénombre de plus en plus de partisans à l'indépendance. Ceux qui soutiennent la domination française sur l'Algérie ne baissent pas les bras. Certains chefs militaires et des colons français organisent un putsch, de peur que le gouvernement français n'entreprenne des négociations avec le FLN. Un comité de salut public est créé à Alger est dirigé par le général Massu. En France, les effets de la guerre commencent à se faire sentir dans le domaine économique; la guerre coûte très cher et atteint moralement la population. L'opinion publique est très divisée au sujet de l'indépendance. Le 13 mai 1958, une crise débute et la IVe République tombe. Le général de Gaulle est convoqué par René Coty, le président, pour former un nouveau gouvernement, capable de régler la crise tout en évitant la guerre civile. Quelques mois plus tard, le FLN crée son propre gouvernement provisoire de la République algérienne (G.P.R.A.). Des pourparlers ont lieu entre de Gaulle et le G.P.R.A. Un deuxième putsch, le "putsch des généraux" est tenté en vain par les généraux Jouhaud, Salan, Zeller et Challe. Le général Salan est déterminé à garder l'Algérie sous la tutelle française et créé l'OAS, l'Organisation armée secrète. De nouveaux attentats ont lieu. Ces actes de terrorisme ont pour but d'augmenter la pression des partisans à l'indépendance.
Malgré un référendum en mai 1961, accordant l'autodétermination de l'Algérie, des Français et les Algériens tiennent des négociations secrètes à Évian-les-Bains. Les accords d'Évian sont signés par de Gaulle et le G.P.R.A, près d'un an après lesdites négociations, alors que l'OAS frappe encore; cette fois, neuf personnes sont tuées à Paris, dans la station de métro Charonne. Ces accords octroient la souveraineté de l'Algérie face à la France. Un cessez-le-feu est par la suite négocié. L'indépendance est votée majoritairement et presque à l'unanimité par les Algériens, lors du référendum de juillet 1961. La France n'à d'autre choix que de reconnaître l'indépendance de sa colonie ayant à sa tête Ahmed Ben Bella, nommé, par la suite, président de la République le 15 septembre 1963.
Toujours dans la controverse, la guerre d'Algérie est encore aujourd'hui considérée comme un épisode sombre et difficile à accepter pour la France. Plus d'un million de Français (nommés "pieds noirs") ont préféré l'exil vers la France plutôt que de rester dans cette ex-colonie, craignant des "vengeances" des Algériens. Des notables algériens, restés fidèles à la France, n'ont pas le même point de vue: plusieurs d'entre eux ont été victimes de massacres. La guerre de libération a fait un total d'un million et demi million de victimes. Cette guerre a laisser la société algérienne bouleversée, des orphelins pour cause du décès de leurs parents et proches, parmi eux, le village IGHRAM a enregistrer beaucoup de martyrs.
Posté Le : 14/07/2009
Posté par : nassima-v
Source : www.ighram.net