
Editions Barzakh, Faire des livres qu’on aime
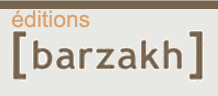
Comment en êtes-vous venus à recourir à des soutiens financiers européens pour financer vos projets?
S. Hadjaj- En 1999-2000, l’Etat algérien achevait de se désengager de la sphère culturelle. Aux acteurs culturels il disait: débrouillez vous, je ne peux plus vous soutenir qu’occasionnellement. Le regard qu’à travers ce discours, il portait sur la culture mérite d’être étudié. C’est en fait un regard de commisération. Autrement dit, le soutien qu’il se proposait d’apporter occasionnellement aux acteurs culturels ne pouvait être qu’un geste de générosité, de charité.
Depuis la fin des années 90 donc, l’Etat ne finance que ponctuellement des projets artistiques ou éditoriaux. Ce financement étatique se fait à travers le Fonds des arts et des lettres (dépendant du ministère de la Culture) ou à l’occasion de grandes manifestations culturelle de grande envergure comme «L’année de l’Algérie en France» (2003) ou «Alger capitale de la culture arabe» (2007).
Le Fonds des arts et des lettres, c’est très bien. Le seul problème est qu’il soutient les écrivains, les artistes, etc. en tant qu’individualités. Un acteur culturel comme Barzakh n’a pas droit à son appui. «L’année de l’Algérie en France» a été un bon moteur pour l’activité éditoriale (et plus généralement artistique). L’Etat a financé un large programme d’édition et d’acquisition de livres. Le problème est que de pareilles manifestations ne s’organisent pas tous les ans et que leur effet sur le marché du livre ne peut être que ponctuel. Nous demeurons malheureusement dans une logique évènementielle et non de prospective. Le marché du livre ne peut se structurer que grâce à une demande locale régulière – dans laquelle certainement le pouvoir d'achat, la qualité de vie en général ont un rôle déterminant –, celle du public et à celle des bibliothèques communales et scolaires, des maisons de jeunes, des maisons de la culture, etc. Nous n'en sommes pas encore là.
Pour me résumer, je dirais donc que ce contexte de désengagement de l’Etat de la sphère culturelle explique en partie notre décision de recourir à des financements étrangers. Mais ce n’est pas la seule explication. A l’occasion de manifestations comme «l’année de l’Algérie en France», l’Etat débloque beaucoup d’argent pour la création mais il le fait en exprimant un certain nombre d’«attentes», de «souhaits». Or, les éditeurs ne sont pas encore assez solides pour se sentir libres vis-à-vis de ces «attentes» de l’Etat. L’Etat, en fait, attend des éditeurs un certain type de projets parce qu’il veut valoriser au niveau national ou international, en même temps que l’image de l’Algérie, sa propre image à lui. Nous sommes otages de ces attentes des institutions culturelles algériennes, du moins telles qu’elles fonctionnent actuellement. Nous ne pouvons pas leur proposer de projets un peu fous, un peu délirants ; nous ne pouvons pas leur proposer des projets critiques, etc. Il ne faut bien entendu pas généraliser à outrance ces propos. En 2005, le Ministère de la Culture nous a accordé une aide importante pour l'édition en un seul volume de la Trilogie Algérie de Mohammed Dib.
Peux-tu nous donner un aperçu des projets dans lesquels Barzakh é été soutenu par des partenaires européens?
Lorsque Selma Hellal et moi-même nous avons créé notre maison d’édition en février 2000, notre projet – naïf et maladroit dans sa formulation économique – était de publier de jeunes écrivains algériens (romanciers, nouvellistes, poètes, etc.), de publier de la littérature algérienne pour des lecteurs algériens vivant en Algérie. Ce projet, nous l’avons conçu dans un contexte très particulier, celui de l’Algérie de la fin des années 90, que je viens de décrire un peu. Au bout de 10 années de crise politique, beaucoup d’auteurs algériens avaient quitté l’Algérie, qui vers la France qui vers des pays arabes. Ces auteurs n’étaient plus édités dans leur propre pays. En revanche, ils faisaient le bonheur d’éditeurs européens ou proche-orientaux.
Pourquoi je disais que notre projet était naïf et maladroit? Parce que qui dit publication dit "marché du livre". Or, à cette époque-là, en 1999-2000, la situation de l’édition algérienne était un total désastre. Barzakh est né juste après la liquidation de plusieurs entreprises publiques du livre ainsi que de tout leur réseau de librairies. Il en était fini d’une certaine politique étatique dans le domaine de l’édition, d’une époque où l’Etat contrôlait et subventionnait généreusement de bout en bout la chaîne du livre. Mais aucune politique alternative n’avait été mise en oeuvre. C’était le vide. La majorité écrasante des librairies algériennes (des librairies d’Etat) avaient été vendues ou étaient en phase de l’être. A un niveau économique plus général, c’était la crise : l’Algérie ne connaissait pas l’aisance financière qu’elle connaît aujourd’hui. Il n’y avait pas de place pour la «consommation culturelle», dans une situation où le prix d’un beau livre représentait quelquefois le tiers du salaire minimum garanti.
Dès que nous avons publié nos premiers ouvrages, nous nous sommes rendus compte que le marché n’était pas viable, qu’il était trop instable et que l’environnement culturel ne nous était pas favorable (peu d’émissions culturelles ou littéraires, critique journalistique quasi-absente, etc.). Nous nous sommes rendus compte que nous étions dans une situation de totale précarité. Ceci nous a imposé de nous poser autrement la question des moyens permettant de créer, en Algérie, une édition littéraire de qualité. Nous nous sommes mis à rechercher des soutiens à défaut de bénéficier d'une politique du livre forte et cohérente dont l'initiateur aurait forcément été l'Etat. En Algérie, les soutiens pouvaient être de deux sortes. Ils pouvaient être institutionnels (le Fonds des arts et des lettres) ou étrangers (l’Union européenne, le Centre culturel français pour l’édition francophone).
Nous avons sollicité ces différents soutiens pour la publication de nos livres et l’organisation de nos événements. Le premier événement que nous avons organisé grâce à ces soutiens est une exposition de peinture d’Azouaou Mameri (décembre 2000). Cette exposition avait été soutenue par l’Union européenne. La première aide que nous a apporté le CCF a pris la forme d’acquisition de lots de nos livres mis à la disposition d’associations algériennes d’enseignants de langue française. C’était en 2001.
L’aide du CCF nous a été bénéfique. Elle a permis d’injecter dans nos caisses de l’argent que nous avons utilisé pour financer d’autres projets d’édition. Mais cette aide présentait une limite évidente. Elle ne pouvait être que ponctuelle et, de ce point de vue, elle ne permettait pas de structurer notre maison d’édition. C’est le marché qui structure à 60 à 70% une maison d’édition même si, on ne le répétera jamais assez, l'économie du livre est particulière. Tout en étant régi par la logique économique générale, elle possède des spécificités que lui confère le rôle qu’y joue l’intervention de l’Etat et d’autres acteurs culturels (institutions culturelles étrangères, sponsors privés nationaux ou étrangers…).
Très vite donc, l’aide qu’apportaient des partenaires européens est allée dans deux directions : la formation et le financement de l’achat de droits d’auteurs. J’ai participé moi-même à Paris à une formation financée par le CCF. Selma Hellal a pris part à une formation à Francfort financée par le Goethe Institue. Ces formations nous ont permis d’en savoir plus sur le fonctionnement du marché du livre dans les pays européens. Cela nous a été très utile même s’il n’y pas de comparaison possible entre ce marché et le marché du livre algérien. Cela nous a permis aussi une ouverture utile sur d’autres expériences…
Qu’en est-il du financement de l’acquisition de droits d’auteurs?
L’autre direction dans laquelle est allé le soutien européen est, comme je le disais, le financement de l’achat de droits d’auteurs. La production locale de livres est faible et, pour nombre d’auteurs algériens, le marché français est plus attractif que le marché national. Le meilleur de la production algérienne francophone se fait en France; en Algérie, cette production est proposée au public à des prix inaccessibles. La solution, pour pouvoir mettre sur le marché national la littérature algérienne francophone paraissant en France, était évidente: acheter des droits d’auteurs aux éditeurs français. Pour éviter que le coût de ces droits ne se reflète sur le prix de vente, le bureau du livre de l’ambassade de France à Alger s’est chargé d’acquérir ces droits au profit des éditeurs algériens. Cette aide a permis à Barzakh de rendre abordables un certain nombre d’ouvrages d’auteurs algériens ou concernant l’Algérie qui paraissaient uniquement en France et dont le lectorat algérien était frustré.
Un autre exemple de coopération, notre collaboration avec la fondation suisse Pro-Helvetia dans le cadre du projet appelé «L’autre Méditerranée». Ce projet s’articulait autour de la question des échanges culturels entre les deux rives de la Méditerranée: comment les développer? Comment aider les créateurs sud-méditerrannéens, à travailler dans de meilleures conditions etc.? Nous avons organisé avec Pro-Helvetia un certain nombre d’événements, comme ce colloque sur la traduction littéraire et le bilinguisme (Alger, 2002). Nous avons aussi participé à cette belle aventure qu’a été l’ouvrage Territoire Méditerranée (2003). Ce livre a été une récapitulation de l’expérience du projet «L’autre Méditerranée», une récapitulation qui la «problématisait» pour en comprendre les bienfaits, les manques, etc. On s’y posait des questions pertinentes: le financement du travail d’un artiste par une partie européenne se ressent-il au niveau du travail de cet artiste? Quelle est l’influence réelle des échanges culturels sur la perception que chacune des deux rives de la Méditerranée a de l’autre? Etc. Etc.
Quel bilan fais-tu de toutes ces expériences? Quels ont été les «gains» pour Barzakh?
D’abord un gain économique évident! Lorsqu’on reçoit des soutiens autres, on travaille dans des conditions plus confortables. Cela permet de réaliser les projets qu’on «a envie» de réaliser. Ce qu’on n’explique pas assez, c’est qu’un éditeur ne fait pas uniquement des livres qui «marchent» mais aussi des livres qu’il «aime». Nous, à Barzakh, nous ne désirons pas publier seulement des livres qui correspondent aux attentes supposées du public. Ce public, nous avons envie de le surprendre, de lui faire découvrir d’autres choses, d’autres auteurs. Si nous ne devions publier que ce qui correspond à ses attentes présumées, nous n’éditerions que des livres d’histoire, des manuels parascolaires ou des livres de cuisine! Sans même parler du livre à caractère religieux, qui nécessiterait un développement à part… Je parle d’«attentes supposées du public» parce qu’aucun sondage, aucune étude sérieuse ne nous a encore permis de nous faire une idée précise du lectorat algérien, de ce qu’il aime ou n’aime pas, dans quelle langue il lit tel ou tel type de livre (parce qu'il y a un vrai particularisme linguistique en Algérie), du taux d'alphabétisation,… A Barzakh, nous pensons qu’il est nécessaire de publier de la littérature même et, surtout, dans un pays où, à cause des années de crise politique et de la dégradation du pouvoir d’achat, elle peut paraître comme un produit de luxe. Et c’est pour cette raison que nous faisons tout (y compris accepter des soutiens financiers étrangers) afin que l'ouvrage littéraire soit accessible au public le plus large possible.
Le risque inhérent à ce genre de soutiens financiers est le suivant: ils nous mettent plus à l’aise économiquement et par conséquent, on risque de se détourner de l’objectif principal de tout éditeur: toucher un lectorat précis, aider à le constituer, développer la lecture publique, le marché national du livre, etc. Le risque en fait est celui de ne plus faire que des livres qui nous plaisent mais qui ne correspondent pas à une attente – réelle ou virtuelle – du public. Toute la difficulté est de se maintenir dans le juste milieu : faire des livres qu’on aime mais pour les proposer à un public réel.
Nous avons publié, il y a un an, un livre intitulé Alger 1951. C’est une collection de photos réalisées en Algérie dans les années 50 par Etienne Sved, un photographe juif hongrois. Nous avons accompagné ces photos de textes écrits par trois auteurs différents (l’historien Benjamin Stora, le poète et spécialiste de la photographie coloniale, Malek Alloula et la romancière Maissa Bey). L’aide que nous a apportée le Centre culturel français a permis qu’Alger 1951, un beau livre soit vendu à seulement 1500 dinars. Ce prix est évidemment élevé au regard du pouvoir d’achat moyen, mais sans le soutien du CCF, il l’aurait été encore plus. Alger 1951 a été, pour nous, un succès éditorial mais aussi un succès au niveau des ventes. Cependant, nous aurions dû probablement penser à l’éditer en parallèle sous une autre forme plus cheap, moins soigné afin qu’il puisse se vendre à 400 dinars, par exemple, et qu’il soit ainsi accessible à un plus large public.
Peux-tu nous dire si Barzakh (ou un autre acteur culturel algérien) est tombé dans ce travers que tu décris, celui de produire des œuvres en totale déconnexion avec les attentes et les goûts présumés du public?
Il est difficile de répondre à cette question. Ce qui est certain, c’est que nous nous posons tous les jours la même question: comment concilier nos «coups de cœurs», nos préférences avec ce qu’exige de nous le marché? La publication d’ouvrages littéraires est la raison d’être de Barzakh, même si nous avons développé d’autres produits (histoire, essais, beaux livres, etc.). La double règle que nous essayons d’appliquer est la suivante: publier des livres que nous aimons mais qui rendent compte aussi, d’une façon ou d’une autre, de l’Algérie. Quelquefois, évidemment, nous en arrivons à publier des ouvrages que nous n’aimons pas forcément en tant qu’amateurs de littérature mais qui, à notre sens, rendent compte d’une certaine réalité, disent quelque chose à propos de ce pays qu’est l’Algérie.
En même temps, j’insiste pour dire que les soutiens et l’aide que nous apportent nos partenaires sur certains projets précis nous permettent quelques fois de faire des livres que nous aimerions faire sans se poser la question de leur « vendabilité ».
On pourrait vous faire remarquer que, malgré tous ces projets de partenariat avec des institutions européennes, la situation de l’édition algérienne et du marché du livre n’a pas beaucoup évolué…
Est-ce que cette coopération a été utile? Ma réponse à cette question, à un certain moment, était tout à fait catégorique: oui, cela a été utile, cela a permis d’être dans un échange continu avec l’autre et, par conséquent, de nuancer le point de vue sommaire qu’on pouvait avoir de lui, etc., cela a permis aux acteurs culturels d’avoir une marge de manoeuvre plus large, aux éditeurs par exemple, de publier des livres qu’ils rêvent de publier, etc.
Au bout d’un certain temps, je me suis rendu compte que pareils arguments pouvaient facilement être démontés par une argumentation qui alignerait les chiffres pour prouver que l’édition littéraire algérienne n’a pas réellement évolué malgré cette coopération avec des institutions européennes, que le marché du livre n’est toujours pas bien structuré, que la situation financière des maisons d’édition qui publient de la littérature demeure précaire, etc. La logique des chiffres est pernicieuse. Elle pourrait nous pousser au désespoir complet.
Ce qu’on peut opposer à ce genre d’argumentaire pessimiste est une simple question: si ces projets de partenariat n’avaient pas existé, quelle serait la situation aujourd’hui? Moi, je me pose en permanence la question: si Barzakh ou un autre éditeur, Casbah, n’existait pas, quel serait la situation de l’édition algérienne actuellement? Je réponds à cette question en affirmant, en dépit de la logique des chiffres, que l’existence de Barzakh a été utile. Si Barzakh n’existait pas, il y aurait quelque chose en moins. De même, si la coopération culturelle avec des institutions européenne n’existait pas, il y aurait quelque chose en moins. La situation de l’édition algérienne ne serait pas tout à fait la même. Barzakh et d’autres éditeurs n’auraient pas la visibilité qu’ils ont aujourd’hui. Barzakh est aujourd’hui plus visible qu’il y a 7 ans, son action est plus pérenne et son identité mieux établie. Tout le monde sait aujourd’hui qui nous sommes, quels types de livres nous publions. Tout le monde nous reconnaît le rôle de passerelle entre différentes générations de créateurs, différents genres artistiques et différentes langues de création.
Ne penses-tu pas que le recours fréquent aux soutiens étrangers peut détourner l’attention des acteurs culturels d’une revendication légitime, celle de subventions étatiques plus conséquentes à la culture?
Je ne le crois pas. Par le biais des syndicats des éditeurs nous continuons à revendiquer toujours la même chose: une politique nationale du livre qui aide à structurer le marché algérien du livre car nous - la corporation des éditeurs, NDR - nous savons pertinemment que sans politique du livre nous ne survivrons pas longtemps ou nous serons toujours suspendus aux aides extérieures (forcément ponctuelles et discriminantes) ou à la nécessité de publier essentiellement des manuels parascolaires. Une politique du livre suppose, d'une part, une réflexion de fond sur la lecture publique (un réseau de bibliothèque, des commandes précises, des aides à l'écriture ou à l'édition,…) et, d'autre part, la mise en place d'un arsenal juridique et fiscal à même de garantir la pérennité de notre travail par le biais d'une loi-cadre sur le livre (détaxation des intrants – papier, encre,… – baisse des charges, facilitation pour l'accès aux crédits d'investissement,…). Tout ceci n'existe pas, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de choses à réaliser et qu'il serait bon de profiter de l'embellie financière de l'Algérie pour initier cette action.
Les institutions culturelles nationales, en vous soutenant, expriment un certain nombre d’«attentes» et de «souhaits». Qu’en est-il des financeurs étrangers?
Les attentes des financeurs étrangers dépendent de l’image qu’ils se font de l’Algérie. Dans les années 90, elles tournaient autour de la question des femmes, des libertés individuelles menacées, etc. Un peu plus tard, avec l’évolution du contexte politique, elles tournaient autour de la question de la liberté d’expression, de la lutte contre la censure: on soutenait des créateurs muselés, dont la parole était réprimée, etc. On leur proposait des résidences et des bourses d’écriture, etc.
Aujourd’hui, à mesure que la situation politique évolue, les attentes des financiers européens changent. On peut, par conséquent, financer aujourd’hui d’autres types de projets. Notre leitmotiv, pendant des années, a été le suivant: les choses sont plus complexes qu’il n’y paraît. Nous avons souvent dit à nos partenaires: il est intéressant de financer le travail de tel ou tel artiste ou écrivain même s’il n’évoque pas dans son travail le terrorisme ni la cause des femmes.
En tant qu’acteurs culturels indépendants, nous appartenons à ce qu’on appelle la «société civile». Ce qui intéresse les partenaires étrangers, c’est d’aider au développement de cette société civile, de lui donner les moyens d’une réelle indépendance. La question, pour nous, est la suivante: comment cela peut-il se faire tout en veillant à ce que cette société civile ne devienne otage ni des uns ni des autres et qu'elle demeure représentative de la société dont elle émane?
Quel est le «gain» qu’ont pu réaliser vos partenaires étrangers à travers leur coopération avec vous ou avec d’autres acteurs culturels en Algérie?
Je ne sais pas si c’est à moi de répondre à cette question. En tout cas, le gain est visible au moins pour les structures culturelles françaises (CCF, ministère de la culture, associations de la francophonie, fondations particulières, associations locales ou régionales, etc.), intéressées au développement et à la promotion de la francophonie. Ce qui intéresse ces structures en finançant la bourse d’écriture d’un écrivain, c’est de perpétuer la présence de la langue française en Algérie. Les gains sont moins concrets, moins quantifiables pour d’autres structures européennes, lorsqu’elles financent l’exposition d’un plasticien, l’installation d’un artiste, etc. Ce qu’on attend de nous, à mon avis, c’est que notre action puisse être pérennisée.
Est-ce que ces projets de coopération ont aidé Barzakh à mieux se structurer et à pérenniser son action?
Comme je le disais tout à l’heure, les soutiens financiers que nous avons reçus nous ont permis de réaliser des projets que nous voulions réaliser. Ils nous ont permis de les réaliser dans des conditions financières plus confortables.
Notre participation à des partenariats culturels avec des structures européennes, les voyages que nous effectuons dans ce cadre, etc., tout cela nous a été très utile. Participer à des salons internationaux du livre, cela permet non seulement de comprendre le fonctionnement du marché mondial du livre, mais aussi de découvrir que les problèmes de l’édition littéraire algérienne ne sont pas uniques au monde, qu’ils sont semblables à ceux de l’édition turque, égyptienne ou bosniaque... Cela permet ainsi une ouverture d’esprit sur le reste du monde et, naturellement, de tout voir sous l’angle de la relativité.
Ces partenariats nous permettent d’être dans une interrogation continue sur notre travail.
S’ils n’existaient pas, nous nous poserions certes des questions sur notre action, mais nous nous les poserions autrement et les réponses seraient nettement plus simples. Nous nous poserions certes la question de savoir quels livres éditer mais nous y répondrions invariablement: des mémoires, des livres d’histoire, des manuels parascolaire. Grâce à ces partenariats, notre marge de manoeuvre s’est élargie et nous nous posons autrement la question de nos choix éditoriaux. Nous pouvons publier des livres que nous aimons, ce qui n’est pas rien. Nous pouvons les proposer aux lecteurs à des prix plus abordables que si nous n’étions pas soutenus. Les soutiens de nos partenaires nous permettent de faire des livres beaux, fabriqués aux normes universelles. Ils nous permettent en deux mots de nous professionnaliser davantage.
La coopération culturelle avec des structures européennes s’est faite dans des conditions mondiales particulières, caractérisées par l’exacerbation des tensions politiques et «culturelles» entre l’Occident et le monde arabo-musulman. A-t-elle permis, selon toi, une meilleure compréhension mutuelle entre les Européens et le monde arabo-musulman?
Deux éléments pour répondre à cette question. D'une part ce sont les créateurs au sens large du terme qui font avancer les choses, qui permettent de réfléchir, d'être ému ou sensibilisé. Ce sont eux qui accroissent notre connaissance de telle ou telle géographie humaine du monde. C'est par la philosophie, la littérature ou le cinéma que nous appréhendons mieux le monde, pour peu que ces œuvres soient esthétiquement fortes, qu'elles soient aussi radicales, cohérentes et qu'elles appartiennent en propre à un lieu donné, meilleure façon de s'ouvrir au monde. Rien ne vaut un grand roman ou un grand film pour altérer quelque peu les mentalités et les préjugés dominants. Mais d'un autre côté il faut que ces œuvres circulent, soient vues, lues par le maximum de personnes ou pour qu'il y ait un retentissement médiatique minimum. Et là la "coopération culturelle" peut beaucoup pour abattre les barrières mentales, économiques ou policières! Tout ceci dans un contexte de domination américaine. L'Institut du Monde Arabe à Paris est inestimable dans ce contexte, et il faut toujours se poser la question dans le sens: qu'y aurait-il s'il n'existait pas? Peut-être rien et c'est effrayant de penser cela… Alors, évidemment il faut du volontarisme, il faut de la générosité, car les chantiers sont infinis en matière de diffusion des savoirs, d'édition, de traduction, de financement des projets lourds (le cinéma, la musique ou le théâtre), de médiatisation…
Posté Le : 22/02/2007
Posté par : nassima-v
Ecrit par : Yassin Temlali
Source : www.babelmed.net